La guerre: Les facteurs historiques
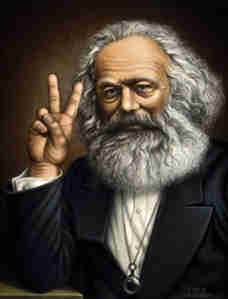 La guerre fait l’histoire qui la fait.
La guerre fait l’histoire qui la fait.
Selon la thèse historiciste, la guerre n’est ni naturelle (issue d’un prétendu instinct agressif), ni artificielle (née du caprice d’un capitaine) ; elle est le produit de circonstances historiques déterminées. Telle fut l’une des grandes intuitions de Montesquieu qui, à rebours de Hobbes, écrivait : « Sitôt que les hommes sont en société, ils perdent le sentiment de leur faiblesse ; l’égalité qui était entre eux cesse et l’état de guerre commence ».
Dans son Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, Rousseau défend une thèse analogue : dans l’état de nature d’avant l’histoire, l’homme mène une vie globalement paisible – c’est avec l’apparition de la propriété (le résultat d’une violence : l’acte d’appropriation), et la substitution de l’amour-propre à l’amour de soi que les guerres vont surgir. Dans un court texte intitulé « Que l’état de nature naît de l’état social », Rousseau admet que « dans les querelles sans arbitres qui peuvent s’élever dans l’état de nature, un homme irrité pourra quelquefois en tuer un autre, soit à force ouverte, soit par surprise », « qu’il peut y avoir des combats et des meurtres, mais jamais ou très rarement de longues inimitiés et des guerres ». L’homme sauvage peut être violent à l’occasion, il ne fait pas, à proprement parler, la guerre.
Une thèse semblable sera défendue par Marx : la lutte des classes qui est la guerre entre les propriétaires des moyens de production et ceux qui ne disposent que de leur force de travail commence avec la propriété privée, donc avec la fin du communisme primitif. Lorsque l’exploitation d’une classe par l’autre sera abolie, dit Marx, la guerre devrait cesser d’exister.
Bergson dira pareillement que « l’origine de la guerre est la propriété individuelle ou collective » mais il ajoute que puisque « l’humanité est prédestinée à la propriété par sa structure », « la guerre est naturelle ».
Ces hypothèses ont été globalement confirmées par la paléontologie. Des récentes recherches tendent à prouver que jusqu’au néolithique (vers -10 000) l’homme de la Préhistoire n’a pas connu la guerre. La « guerre du feu » imaginée par Rosny Aîné est une fiction littéraire, pas une réalité historique.
Contre qui l’homme préhistorique aurait-il fait la guerre ? Certainement pas contre un ennemi cherchant à établir une hégémonie territoriale. Les espaces sont infinis, le gibier uniformément répandu. Les affrontements entre bandes, lorsqu’ils avaient lieu, ne dépassaient pas le niveau de la bagarre.
Vers -8 000, cet équilibre va petit à petit être rompu. Tout semble être parti de facteurs climatiques : avec le lent réchauffement de la Terre, une série de réactions en chaîne conduit aux premières guerres. Sur les sédiments amassés durant des millénaires au fond des vallées et abandonnés par les glaciers en recul général, des graminées et de l’herbe vont pousser, la chaleur aidant. Cette herbe neuve servira de nourriture à de nouvelles espèces herbivores, au premier rang desquelles le mouton, prolifique et facile à domestiquer.
L’élevage et l’agriculture remplacent petit à petit la chasse et la cueillette en divers points du globe. Plusieurs populations humaines quittent alors leurs habitudes de nomades : les premiers campements permanents constituent les embryons des premières villes. Pour la première fois depuis l’apparition d’Homos sapiens, on assiste à une accumulation de richesses (poteries, outils, vêtements…). Ce capital attire les pillards : avec la révolution du néolithique, les guerriers remplacent les chasseurs. En outre, c’est à cette époque qu’apparaît la première métallurgie capable de fabriquer des armes autrement plus meurtrières que les outils en bois et en os de l’âge précédent.
Ainsi l’universalité historique de la guerre n’impliquera-t-elle pas nécessairement une nécessité anthropologique. Les pacifistes qui rêvent à un dépassement de cette « histoire » (ou, pour dire comme Marx, de cette « préhistoire ») peuvent tirer de ce fait argument.
Les facteurs économiques:
 Le sens économique de la guerre est repérable à toutes ses étapes : avant (on a attribué à Bismarck la célèbre formule : « l’argent est le nerf de la guerre »), pendant (la guerre correspond à une formidable destruction de biens matériels), et après (le travail de reconstruction). D’où la thèse selon laquelle les facteurs déterminants des guerres sont économiques.
Le sens économique de la guerre est repérable à toutes ses étapes : avant (on a attribué à Bismarck la célèbre formule : « l’argent est le nerf de la guerre »), pendant (la guerre correspond à une formidable destruction de biens matériels), et après (le travail de reconstruction). D’où la thèse selon laquelle les facteurs déterminants des guerres sont économiques.
Proudhon voyait dans le « paupérisme » la cause première de la guerre. Faire la guerre, c’est s’emparer de ce que l’on n’a pas et dont on a besoin. Dans le cadre d’une économie de la rareté, la rapine est le moyen le plus direct de s’approprier une richesse. La guerre serait en quelque sorte un moyen collectif et organisé de voler sur une échelle colossale. De fait, la pauvreté apparaît aujourd’hui comme le principal facteur de guerre. Les quatre cinquièmes des pays que l’on appelle pudiquement les moins avancés (PMA) ont connu un épisode de conflit armé au cours des quinze dernières années et la majorité des conflits s’y déroulent aujourd’hui. On appelle trappe à conflit le cercle vicieux qui fait que la misère et la guerre s’entretiennent mutuellement : dans un pays démuni, la guerre est le moyen le plus direct et le plus efficace pour s’approprier des richesses ; mais elle plonge du coup le pays dans une situation de pauvreté encore plus grande.
Par ailleurs, plus la croissance est faible, plus la dépendance à l’égard des matières premières est forte et le revenu par habitant à la fois limité et inégalement réparti. Dans ce contexte, la guerre remplace le travail. Le phénomène de la trappe à conflit rend très difficile l’extinction d’une guerre une fois que celle-ci a été déclenchée, et même lorsque la paix revient, la situation demeure très instable. Le résultat en est que le fait pour un pays d’avoir été en guerre accroît la probabilité de l’être à nouveau.
Il est à noter d’ailleurs que l’abondance peut conduire à la guerre au même titre que la pénurie. Le bullionisme (de l’anglais bullion, lingot) est une forme primitive de mercantilisme reposant sur le principe que le premier objectif du commerce extérieur est pour un Etat de se procurer une quantité maximale de monnaie métallique afin d’alimenter le trésor de guerre. Il ne s’agissait pas alors de sortir par la violence collective de la misère extrême mais d’accroître une richesse déjà acquise. De même, les guerres coloniales ont été conduites par des pays riches contre des pays pauvres, leur but étant non de sortir de la misère mais d’élargir l’abondance. On a vu l’État industriel, qu’Auguste Comte et Spencer, à la suite de Saint-Simon, regardaient comme incompatible avec l’État militaire, se transformer en redoutable machine de guerre. Le progrès conduit à la guerre plus sûrement que la guerre ne favorise le progrès industriel. Corollairement, l’histoire des deux derniers siècles confirme que le système capitaliste n’a jamais été plus dynamique que durant la guerre (l’effort de guerre) ou immédiatement après elle (le travail de reconstruction). Le cynisme du marchand de canons est pour des raisons évidentes difficilement avouable. Mais l’argument peut être aisément développé : la guerre a des vertus économiques indéniables elle fait produire, vendre, acheter. En détruisant des biens, elle crée une demande. La formidable croissance économique qu’ont connue l’Europe, les États-Unis et le Japon après 1945 était à la mesure des colossales destructions qu’ils avaient subies. La guerre de Corée a accentué cette dynamique. La guerre illustre en la détournant l’oxymoron par lequel J.A. Schumpeter caractérisait le capitalisme : la destruction créatrice.
À cette dimension matérielle, il convient d’ajouter le facteur social : la guerre donne beaucoup de travail (une expression à entendre aussi en son second sens), grâce à elle un fort chômage peut être résorbé (ce n’est pas tant le New Deal que l’agression japonaise qui a sorti les Etats-Unis de la crise enclenchée en 1929 et mis fin à son chômage de masse).
De toutes les philosophies et écoles de pensée, c’est le marxisme qui, de la manière la plus systématique, accorda pour expliquer les guerres l’importance décisive à l’instance économique. Marx, par exemple, explique la guerre de Sécession en termes économiques1 : certes, la question de l’esclavage n’est pas un simple prétexte mais elle doit justement être analysée en termes économiques plutôt qu’idéologiques.
Gracchus Babeuf avait dit : « Il n’y a jamais eu qu’une guerre éternelle, celle des pauvres contre les riches ». Pour Marx, il n’y a en fait aussi qu’une seule vraie guerre, celle des pauvres contre les riches. Les guerres nationales, selon lui, sont des diversions idéologiques d’où une certaine tension dans la doctrine. La théorie de la guerre-diversion, d’origine machiavélienne, comme celle de la guerre-complot, d’origine voltairienne, contredit par l’espèce de contingence qu’elle introduit la profonde nécessité historique de la guerre. Alors que pour le libéralisme, le capitalisme est pacifique par nature parce que le commerce est son cœur, pour le marxisme, il est guerrier parce que l’exploitation est son âme. D’où la guerre des pauvres contre les riches, et celle des riches contre les pauvres. L’exploitation avive la concurrence : pour Lénine, la guerre de 1914-1918 est le choc entre les impérialismes anglais, français et russe d’un côté, allemand et autrichien de l’autre. La guerre est ou bien l’exploitation ou bien la concurrence continuée avec d’autres moyens. Même les guerres qui semblent avoir des causes idéologiques sont en réalité, selon cette optique matérialiste, déclenchées pour des raisons économiques : la grande crise de 1929 peut être considérée comme la cause principale de la Seconde Guerre mondiale puisque le nazisme lui a dû son accession au pouvoir.
Enfin, le capitalisme moderne trouve un bénéfice direct dans la destruction de biens et de villes sur une vaste échelle. En anéantissant une quantité considérable de richesses, la guerre crée une forte demande et contribue in fine à une augmentation de la production. D’où cette explication finaliste proposée par nombre d’auteurs marxistes : le capitalisme génère la guerre pour faire tourner la machine productive.
L’explication économique s’est vu objecter un certain nombre d’arguments. La théorie de la rareté a été contestée par certains anthropologues, Marshall Sahlins, par exemple, auteur d’un ouvrage intitulé Age de pierre, âge d’abondance. Contrairement à ce qui a été beaucoup dit et répété, la rareté n’est pas une situation permanente et universelle de l’histoire humaine. Celle- ci ne peut pas être considérée comme un cheminement continu qui va du manque et débouche sur la satisfaction. Par ailleurs, il n’y a pas seulement la guerre de conquête, il y a aussi la guerre de dépense.
La guerre, écrit Gaston Bouthoul en une formule qui peut surprendre, « se présente comme une sorte d’activité de luxe1 ». Georges Bataille définissait la guerre comme « une dépense catastrophique de l’énergie excédante ». Il existe une dimension ostentatoire dans la destruction et dont le potlatch analysé par Marcel Mauss est la matérialisation la plus célèbre. Les hommes d’autrefois étaient fiers de leurs pertes, parfois plus encore que de leurs gains. Plus le dommage était grand, et plus noble et prestigieux apparaissait celui qui le supportait. Telle était aussi la logique à l’œuvre dans les privations religieuses (sacrifice, abstinence, jeûne, mutilations et souffrances volontaires). Même si elle tend à s’atténuer au fil du temps, cette dimension festive ne disparaît pas tout à fait : elle se retrouve en 1914 de part et d’autre du Rhin (voir l’image de la fleur au fusil). Dans L’Homme et le sacré, Roger Caillois constate la disparition de la fête dans le monde contemporain et voit dans la guerre ce qui hérite le mieux de ses caractères. Les hommes modernes feraient la guerre au lieu de faire la fête, ils ne feraient plus la fête qu’en faisant la guerre.
Un type de guerre pour lequel le facteur économique semble prévalant est la guerre de débouchés. Mais, même en ce cas, les autres facteurs, idéologiques en particulier, jouent un rôle déterminant. Les crises économiques, même les plus rudes, ne se terminent pas toujours par une guerre et la logique de guerre ne répond pas toujours à la rationalité des besoins.
L’une des rares guerres à avoir eu une motivation économique explicite, la guerre de l’opium, qui opposa l’Angleterre à la Chine au XIXe siècle, ne peut même pas être comprise comme l’effet d’une nécessité économique l’opium pouvant difficilement être considéré comme un produit répondant rationnellement à un besoin. Il n’est évidemment pas question de nier l’existence d’une dimension économique nécessaire de la guerre ; on peut, en revanche, douter qu’elle suffise à faire les guerres.