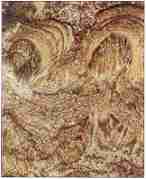Les première trace de vie
Les Les premières traces de vie ont environ 3 milliards 500 millions d’années ; elles ont été découvertes en Australie et en Afrique du Sud.
Il s’agit d’organismes unicellulaires dépourvus de noyau, appelés procaryotes par les biochimistes, et sans doute proches des cyanobactéries (en somme, des microbes). Ces organismes se multipliaient en se divisant pour créer d’autres organismes génétiquement identiques. Ils ont été retrouvés sous forme de fossiles, souvent associés à des structures appelées stromatolithes, que l’on peut encore observer dans la nature. Les stromatolithes consistent en un empilement de fines lamines de calcaire (carbonate de calcium) dû à l’activité photosynthétique de bactéries sous de faibles tranches d’eau. L’apparition du noyau (cellules eucaryotes) interviendra bien plus tard dans l’histoire de la vie et sera probablement le résultat d’une symbiose. Les organites que l’on trouve à l’intérieur des cellules vivantes, comme les mitochondries, ressemblent en effet considérablement à des cellules procaryotes ; l’association de différentes cellules aurait permis la constitution de la cellule eucaryote, cette dernière finissant par atteindre une grande taille en « faisant travailler des microbes à l’intérieur d’elle-même » selon la formule de Jaeger (1996).
Les plus anciennes cellules eucaryotes auraient un milliard et demi d’années. C’est aussi à cette époque que remonterait l’invention d’une « sexualité » primitive, c’est-à-dire la possibilité pour deux organismes de donner naissance, à partir de la combinaison de leurs propres patrimoines génétiques, à un troisième organisme génétiquement différent. Ces échanges, en augmentant la diversité génétique, furent sans doute une cause essentielle de l’accélération de l’évolution au Protérozoïque supérieur. On connaît, dans des roches vieilles de 1 500 millions d’années, des ensembles contigus de deux ou quatre cellules qui suggèrent fortement l’apparition de la sexualité. Dans la foulée, les premiers animaux constitués de plusieurs cellules apparurent il y a environ 1 milliard d’années.
Avec l’apparition du phénomène de la tectonique des plaques, l’émergence de la vie pluricellulaire et 1’« invention » de la sexualité, condition indispensable à la diversité des espèces, l’histoire paléobiogéographique pouvait véritablement commencer.
Le protérozoïque supérieure
Il y a environ 900 millions d’années, la fermeture d’un océan situé approximativement entre l’Amérique du Nord et l’Afrique aurait entraîné la réunification de toutes les masses continentales. Le continent unique ainsi formé a été baptisé Rodinia (du russe rod.it, croître) et l’océan unique qui l’entoure Mirovia (du russe mirovoi, global).
La Rodinia s’est disloquée à la fin du Protérozoïque.
Entre 700 et 500 millions d’années, l’ouverture d’un nouvel océan, le lapetus (de Iapet, père d’Atlas qui a donné son nom à l’océan Atlantique) va séparer la Laurentia de la Baltica et de la Nigritia.
C’est le début d’un grand cycle de dislocation collision qui se terminera à la fin du Paléozoïque, 450 millions d’années plus tard, par la formation d’un nouveau « supercontinent » : la Pangée.
La Laurentia, à l’ouest et sur l’équateur, correspond largement à l’Amérique du Nord d’aujourd’hui (sans la Nouvelle Angleterre et Terre-Neuve, mais avec le nord de l’Irlande et de l’Ecosse) ; la Baltica, située sous les hautes latitudes australes comprend l’Europe du Nord.
Le lapetus est donc installé à peu près sur l’emplacement de l’actuel océan Atlantique.
Plus à l’estrentre l’équateur et le tropique du Capricorne, la Sibéria correspond à la Russie actuelle (à l’est de l’Oural).
Après la fermeture, il y 600 millions d’années, d’un océan qui a séparé l’est et l’ouest de l’Afrique, les autres régions du monde actuel (Afrique, Amérique du Sud, Antarctique, Inde, Chine, Asie du Sud-Est, Australie, Europe méridionale) sont regroupées au sein de la Nigritia.
Peu de roches de cette période ont été trouvées par les géologues et les seules indications paléogéographiques dont on dispose sont données par le paléomagnétisme qui indique la latitude mais pas la longitude. Du fait de cette imprécision, des reconstitutions très différentes de la géographie du Protérozoïque ont été proposées.
Ainsi, sur la carte présentée page suivante, l’Amérique du Nord aurait pu occuper des positions tout à fait différentes et qui néanmoins satisferaient chacune aux données paléomagnétiques actuelles. Cela reflète nos incertitudes quant aux géographies précambriennes.

Sur cette carte représentant la Terre il y a environ 600 M.A., après la dislocation de la Rodinia, la Nigritia regroupe l’Afrique, l’Amérique du Sud, l’Antarctique, l’Inde, la Chine, l’Asie du Sud-Est, l’Australie et l’Europe méridionale.
La Sibèria correspond à la Russie actuelle et la Baltica à l’Europe du Nord tandis que la Laurentia regroupe l’Amérique du Nord et le nord de l’Ecosse et de l’Irlande.
Au début du Protérozoïque supérieur, la vie est uniquement océanique ; peu de phylums sont apparus et l’on ne connaît dans les archives fossiles que les traces d’activités d’organismes unicellulaires comme les stromato lithes, ainsi que de rares organismes pluricellulaires (apparus vers 1 000 millions d’années). Ces faunes rares et mal connues n’apportent pas d’informations biogéographiques.
D’un point de vue paléobiogéographique, la dislocation de la Rodinia (dont les côtes étaient uniformément peuplées par les faunes littorales édiacariennes) a eu des conséquence pour la suite des événements.
En effet, la création de nouveaux domaines marins peu profonds situés sous l’équateur a certainement favorisé l’évolution de nouvelles formes de vie, tandis que leur séparation, au gré de la dérive des continents à la fin du Protérozoïque, a provoqué des évolutions endémiques.
Ces facteurs paléogéographiques sont certainement à l’origine de ce que l’on appelle « l’explosion cambrienne », c’est-à-dire la brutale diversification des formes de vie au début du Paléozoïque.